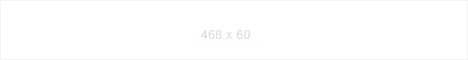LA CLASSE OUVRIERE C’EST PAS DU CINEMA 12 ème rencontre. 2015.
Organisée par Espace Marx à l’Utopia de Bordeaux, cette 12ème rencontre, comme celles des années précédentes, proposait des films et documentaires rarement programmés, au cours de journées thématiques où les discussions ont été animées : « Cinéma et colonialisme », « Milos Jancso », « Gérard Mordillat » « Comment préserver sa santé au travail », « violence latino-américaines », « René Allio, cinéaste de la parole populaire ». .
Mercredi 11 Février : 1945/2015 Regards de cinéastes sur l’histoire coloniale.
-« Les massacres de Sétif. Un certain 8 mai 1945. » Mehdi Lallaoui et Bernard Langlois
(documentaire 1995.)
Pour qui l’ignore, il faut savoir que le jour de la libération en France a eu son corollaire en Algérie où plusieurs manifestations pacifiques ont été organisées par le mouvement nationaliste : « Nous voulons être vos égaux !». A Sétif la manifestation dégénère quand un jeune homme brandissant un drapeau algérien est abattu, on dénombre des morts de chaque côté. Les manifestations vont se multiplier et seront réprimées dans le sang. Plusieurs milliers de victimes, côté algérien, jusqu’à la fin du mois de Mai. 1500 morts officiels, 30 000 selon d’autres estimations.
Le film mêle documents d’époque et interviews de personnes ayant assisté et participé à ces évènements, côté français et algérien. Des personnalités, comme José Abouker, Jules Roy, de simples personnes, comme ce soldat algérien qui rentre de la guerre où il a combattu aux côtés des français et découvre que sa famille a été massacrée. Le ton neutre du film rend toutes ces images d’autant plus accablantes. Ce qui ressort de ce film – c’est-à-dire la seule explication qui nous en est donnée par les protagonistes de l’époque- c’est que seule la peur est en cause. Peur de la révolte, peur des colons qui étaient en nombre inférieur, peur des réactions en France d’où la chape de silence qui a recouvert les évènements.
Un moment rude, mais un moment nécessaire.
-Hommage à Ahmed Bouanani, cinéaste marocain dont l’œuvre commence à être vue, sous l’impulsion de sa fille Touda.
Ahmed Bouanani a suivi une formation de monteur à l’IDHEC dans les années 50 et fut interdit de tournage à son retour au Maroc. Son nom n’apparaît donc au générique que comme monteur. C’est grâce à la bande-son (musiques, bruitages) qu’il détourne la censure et assure à ses films leur valeur subversive.
Ses films sont élaborés à partir d’archives de l’époque de la colonisation et de ses propres images. Ce ne sont pas pour autant de simples documentaires mais des films à part entière, où s’entremêlent témoignages, poésie et vision personnelle.
« Mémoire 14. » (1971) « Mémoire 14 est à l’origine un poème que j’ai écrit en 1967, et dont certain passages sont d’ailleurs utilisés dans le film. C’est à travers des mémoires anachroniques, des mémoires nourries de mythes, que j’essaie de recomposer la « réalité » de mes personnages et de leur univers… »
Le film est une succession de plans contrastés : visages de femmes, d’enfants, de vieillards silencieux, entrecoupés de passages de chars, de soldats, de nuées de sauterelles, de bals musettes, de célébrations militaires de l’époque du protectorat, de paysages… sur fond sonore de soupirs, de chants, de bruits de bombes, de fanfares, de tics tacs d’horloge, de vent violent… à cela s’ajoute une utilisation très habile de la surimpression. Le montage, tantôt très sobre, évoque par sa puissance le cinéma russe ; tantôt chaotique, il traduit les traumatismes subis par la population. Un film magnifique, hélas trop rare.
« 6 et 12 » (1968) à l’origine un film sur la lumière à Casablanca entre 6h du matin et midi, entre le départ au travail et la pose de midi. C’est aussi un film sur la population casablancaise et son adaptation au monde moderne, le tout sur fond de jazz. et de sirènes d’usines.
« Des images à travers une ville -des instants- temps cloîtré ouvert carapaçonné fenêtres dans le vide des yeux fermés entrebâillés agrippés (…)-soudain l’ombre- soudain le bruit de pas- la mer ou le silence- le silence ou le cri- l’attente ou l’angoisse- le sommeil ou l’insomnie- le signe de la lumière jaillit- le cœur entre deux chiffres nos visages pris dans la tourmente les deux chiffres gravés au blanc sur des fronts des regards des corps qui vont tourner dans la tourmente réglés comme des aimants » Ce texte de Bouanani à propos de son film le résume parfaitement et, comme dans « Mémoire 14 », on peut admirer la même virtuosité, et entendre la même interrogation : mais qu’est devenu le peuple marocain ?
- Jeudi 12 Février : La journée Miklos Jancso. ( 1923-2014)
Cinéaste hongrois et auteur de 29 films en cinquante ans, il a connu célébrité et reconnaissance dans les années 1960/ 1970 et bénéficié d’un large financement. Il fait partie des « nouveaux cinémas » qui ont essaimé à travers le monde à la suite de la nouvelle vague (comme J.Skolimowski, M.Forman, M.Bellocchio, G.Rocha et d’autres.) et ajoute à son cinéma une forte dimension nationale et politique. D’abord stalinien, il consacrera ensuite son oeuvre à montrer l’horreur du pouvoir, d’autant que l’Europe centrale, entre les Habsbourg et l’URSS, n’a jamais connu la démocratie. Comme cette dénonciation est impossible, il transposera l’action de ses films dans le passé.
Les sans espoirs (1965) l’action se situe au 19ème siècle, chez les « sans espoirs », bandits d’honneur qui luttent pour la république à la suite des mouvements de 1848. Ils sont impitoyablement pourchassés par le gouverneur et l’armée et se réfugient chez les paysans qui vont finalement les dénoncer.
L’action se situe dans un fortin militaire campé au milieu de la plaine, autant dire l’immensité. La caméra, par d’interminables plans-séquences circulaires réussit à faire de cette immensité un huis clos étouffant dont personne ne peut s’échapper. Pris dans la routine d’exercices abrutissants et humiliants, les prisonniers – bandits supposés et villageois- attendent. Le dénuement de l’image, la beauté des plans donne à ce film une dimension mythique : à l’œuvre, le pouvoir et ses armes préférées, la peur et la délation. En face, une volonté de liberté qui déjà baisse la tête. Dès les premières images, on sait que le gouverneur sortira vainqueur : il a pour lui le pouvoir, le temps, la force, et en face de lui des paysans démunis. Une fatalité aussi écrasante évoque nécessairement le cinéma de K.Dreyer. Un film autant désespéré que révoltant, un constat sans appel.
Rouges et blancs (1968) Censé commémorer la révolution bolchevique de 1917, le film met en scène un épisode de la guerre civile (mars 1919) entre blancs (armée impérialiste) et rouges (les bolcheviques). Il y est question d’une manœuvre pour s’emparer d’une position sur la rive d’un fleuve. Position très modeste qui suscite dans les deux camps le même type de violences et de lâcheté, le même mépris à l’égard des femmes et des populations. L’absurdité de la situation devient parfois surréaliste : dans un bois, un bal est organisé auquel sont contraintes de participer des femmes que l’on a préalablement costumées (côté blanc), une infirmière est sommairement exécutée pour traîtrise alors que les infirmières sont neutres (côté rouge), les exemples ne manquent pas de ces scènes dérisoires ou révoltantes et où des hommes tentent d’affirmer aveuglément leur suprématie. A plusieurs reprises, la caméra tourne à 360° et embrasse la plaine; elle enferme ainsi les soldats dans leur propre regard et individualité, en l’occurrence dans leur fragile solitude. D’où un possible regain de cruauté…
Dans ce film comme dans le précédent, une mécanique infernale est lancée, que rien ne semble pouvoir arrêter. Un film impitoyable.
Il serait passionnant de connaître davantage l’œuvre de Miklos Jancso (« Psaume Rouge », entre autres, couronné à Cannes), lui qui est en outre le grand inspirateur d’un autre cinéaste hongrois, Bela Tarr, dont l’œuvre est également magistrale.
- Dimanche 15 Février : René Allio, cinéaste de la parole populaire.
René Allio peut être considéré comme une sorte de franc tireur, d’artisan du cinéma, qui s’est tenu à l’écart des chemins tracés, notamment la nouvelle vague. Il n’a réalisé que 11 films en 30 ans de carrière : c’est dire s’il prend son temps, le temps de surmonter les difficultés financières, le temps d’élaborer un projet en accord avec toute une équipe. Son cinéma, sans être « militant », n’en est pas moins profondément politique, puisque pour René Allio, filmer, c’est faire évoluer sa perception du monde pour aider à une transformation du monde. Dans ses films on voit un individu face à la société (« La vieille dame indigne » et « Moi, Pierre Rivière… ») ou un groupe face à un système politique (« Les Camisards »).
« La vieille dame indigne » (1965) met en scène une femme qui, au décès de son mari, refuse l’ombre sociale et familiale qui a toujours été la sienne. Elle décide d’exercer son libre arbitre, loin des exigences étriquées de la société et de ses proches. Libertaire, elle accède à son émancipation et la fin du film la montre souriante dans une lumière éclatante.
« Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, mon frère et ma sœur ». (1976). René Allio prend pour base de son film le journal que Pierre Rivière a écrit dans sa prison. C’est le récit d’un fait divers : un jeune paysan, le 3 juin 1835, massacre sa famille à l’exception de son père. Considéré comme l’idiot du village, il est en réalité intelligent et autodidacte. Il ne supporte pas la façon dont son père est maltraité et trahi par sa mère avec la complicité de son frère et de sa sœur. A plusieurs reprises, il ira en référer aux gendarmes mais en vain. Finalement, il décide de faire justice lui-même. Après son acte, il sillonne la campagne pendant un mois avant d’être arrêté. La justice ne sait que faire de lui : criminel ? dément ?
Le choix de René Allio de tourner dans l’endroit même où s’était déroulé le drame avec des acteurs non professionnels donne au film une densité remarquable. Ce qui est exploré, c’est la complexité des relations au sein d’une famille, l’opacité des individus, la solitude sociale et juridique où se trouve reléguée la paysannerie au 19ème siècle…et ce n’est pas sans écho avec notre époque. Michel Foucault, qui a préfacé le journal de Pierre Rivière, écrit : « Tout le drame de Rivière, c’est un drame du Droit, du Code, de la Loi ». René Allio fait revivre Pierre Rivière avec empathie et dans la lumière fragile d’une humanité tragique.
Il faut noter que Nicolas Philibert, qui avait participé à la réalisation du film, est retourné dans le même village 30 ans après et en a rapporté un documentaire « Retour en Normandie », à revoir lui aussi.
« Les Camisards » (1972). Dans les Cévennes, à partir du printemps 1702, des paysans et artisans se révoltent contre le pouvoir royal et l’église catholique, conséquence de la révocation de l’Edit de Nantes qui encourage les persécutions contre les protestants. Cette « guérilla » sera de faible ampleur réelle mais laissera une trace durable par ce qu’elle symbolise : émeute populaire, guerre subversive et libertaire. En épousant la cause des camisards, René Allio n’en demeure pas moins objectif : faiblesse militaire des camisards, lutte vouée à l’échec. Comme dans ses autres films, Il parle de ceux qui n’ont « pas d’histoire » mais dont les aspirations sont nobles. IL les montre dans la simplicité de leur vie et de leurs espérances.
Comme toujours dans son cinéma, il est question de liberté, de dignité et de justice, avec cette affirmation que les aspirations individuelles transforment le monde en devenant un processus collectif…et avec beaucoup de temps.
« Les Camisards » clôturaient en beauté ces rencontres cinématographiques, le genre de manifestation culturelle qui vous laisse à la fin plus intelligent qu’on ne l’était au premier jour. Merci à Espace Marx et à l’Utopia !
Catherine V, Février 2015

Oldelaf – Saint Valentin
octobre 10, 2024
Lofofora – Coeur de cible – 2024
octobre 07, 2024
Madame Robert – C’est pas Blanche-Neige ni Cendrillon
avril 03, 2024
Bukowski – Sortie 23 septembre 2022
septembre 19, 2022
Tagada Jones – A feu et à sang
octobre 22, 2020
Bande Annonce « Adopte un jeune.com »
février 08, 2019
Le premier de l’année est arrivé!
février 07, 2019
L’avalanche Factotum dévale les sommets
décembre 21, 2018
Saint Jacques de Compostelle et quelques aquarelles…
août 27, 2018